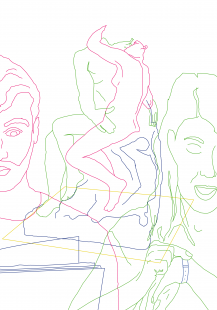Tout commence par un dimanche passé à Rennes. Une journée de pluie (ce jour-là le Bretagne tient ses promesses et assume ses clichés) esseulée pendant un week-end férié. Cette ville, qui fut pourtant mon chez-moi, puis que j’ai désertée pendant plusieurs années, s’offre à moi comme une étrangère. Mais une étrangère qui fait pincer mon cœur et que j’aimerais reconquérir : le temps d’un instant, le temps de souvenirs.
Sans capuche, sans parapluie, c’est le cheveu gonflant et le nez rougi, que je me lance dans cette journée de solitude et de redécouverte de cette ville chérie puis oubliée. Perdue, face à mes bars favoris fermés (ci n’est pas complètement à louer) je cherche de nouveaux refuges.
Je me dirige instinctivement vers le cinéma Arvor, où j’ai déjà passé de longues heures, à l’époque où mon micro-réseau m’y faisait entrer gratuitement : en bonne étudiante à la fac, je n’avais pas ma pareille pour les bons plans culturels. Payant dorénavant toutes mes entrées, tarif plein, ce temps me parait quelque peu lointain.
Le film projeté, ou plus précisément le film dessiné (La jeune fille sans main de Sébastien Laudenbach : une beauté) puis la rencontre avec le musicien qui a réalisé la bande son en improvisant devant le film, m’ont fait passé deux heures, émotives et surtout bien au sec, dans le meilleur refuge qui soit que celle de l’obscurité moelleuse du cinéma. Retour à la réalité quand, le cœur gonflé par cette histoire de jeune fille qui se fait couper les mains, je sors de la salle, seule parmi les couples et les familles, dont j’imagine le déjeuner à venir, au restaurant ou dans des foyers chaleureux… Tandis que moi, j’erre un peu avant d’opter pour une promenade au Parc du Thabor, profitant d’une éclaircie pour voir sa cascade réactivée et ses jardins à la française.
Après un sandwich (pain sec et croûtes qui grattent la gorge, on est loin du rôti des familles) avalé d’un air gêné sous le regard des passants (couples et familles sont comme des épines qu’on enfonce à ma solitude non choisie) puis un petit coucou aux oiseaux de la grande volière, la pluie revient, et pas qu’un peu. C’est donc sous des trombes d’eaux que je me mets à la quête d’un nouveau refuge, pour faire passer à la fois le temps et ma solitude.
Ce sera le Musée des Beaux-arts, où l’on m’accueille très poliment, malgré l’eau qui dégouline de mon front, formant un classieux portrait de moi-même rehaussé du subtile (pas du tout) bruit de mes chaussures non imperméables (un an passé à Marseille et on oublie ce que c’est, le mauvais temps). Malgré ma piètre allure c’est avec une pointe de mystère sur joué et complètement inadéquat que je lance un « oh oui, il y a longtemps… » lorsqu’on me demande si j’ai déjà visité le musée. On me décrit le circuit (d’abord les antiquités, puis les tableaux, avec entre-temps un passage à l’exposition temporaire) avant de me rediriger vers la billetterie (à défaut de tarif étudiant, je gagne encore celui du -26 ans, bingo).
J’entre dans la première salle… Et passe pratiquement 3h dans le musée. Volontairement, et très agréablement. C’est émue et le cœur encore pincé par ce qui prend la forme d’un retour aux sources, pour moi qui n’ai pas vu défiler les années, que je redécouvre les premières sensations des arts visuels et des tableaux étudiés à la fac (coucou Rennes 2 ! Coucou à ton secrétariat moqueur et toujours fermé, à tes amphi non chauffés ou encore tes égouts peut être enfin réparés ? Grands souvenirs.). Cette balade au musée, c’est comme fouiller dans son vieux grenier, tomber sur une boîte à jouets oubliés, d’où émanent des formes, des couleurs, des personnages, et un lot de souvenirs et de sensations d’un temps éloigné. Les tableaux, ces boîtes imaginaires, sont comme autant de madeleines de Proust (j’aime bien écrire cette expression, qui s’accompagne toujours de cette douce – et terre à terre- pensée de l’odeur flottante de madeleines au miel qui cuisent au four…). J’évolue avec grand plaisir entre les vitrines où sont rangés avec précision de multiples objets archéologiques, certains extrêmement minutieux comme ces amulettes égyptiennes représentant des divinités protectrices, ou encore ce crocodile minuscule, qu’on peine à distinguer sans loupe. Les tableaux, réapparaissent à moi tels de vieux (et bons) amis. Je me souviens des jeux de lumières d’un tel ou du destin tragique de l’autre. Les œuvres se laissent de nouveaux conter à moi par leurs histoires, leurs génies, leurs secrets. Je prends le temps de les regarder un à un, d’apprécier les détails de mes préférés (les thèmes antiques), d’englober du regard les scénographies et la richesse qui se forme au travers de grands formats imbriqués les uns dans les autres. J’admire même le design des bancs, leurs placements vis-à-vis des œuvres et dans ces grandes pièces. Je prends soin de bien lire chaque feuille de médiation, prête à croquer la moindre information qui me plaira, à comparer mes propres sensations aux styles et aux époques qu’embrasse le musée.
Alors, je ne suis plus seule.
Mes amis sont Diane chasseresse (the best 3), la princesse Andromède, Dionysos, les bacchantes, Cléopâtre en plein suicide, Madeleine la pénitente, telle mère, telle déesse ou demoiselle (liste concise mais girl power, on n’est pas dans Retard pour rien).
Je contemple aussi pendant très longtemps, les œuvres de Thomas Hubert, qui signe l’exposition temporaire du moment. Je me délecte des couleurs, tente de déchiffrer les thématiques et problématiques, admire la mise en abîme de l’exposition sur elle-même. Je termine ma visite par le cabinet de curiosités, qui regroupe de délicates œuvres d’art, avec des trésors archéologiques et ethnologiques ou encore des mobiliers, dans l’ambiance confinée et obscure de ces pièces confidentielles.
Je passe enfin à la librairie / boutique, où je feuillette les éditions du musée et le catalogue d’exposition, qui me donne, comme souvent, des envies de possession matérielle. Je reprends enfin mes affaires dans mon casier, où mon téléphone a sagement chargé (bien vu les prises dans les casiers de vestiaire !) Bref, je vis tout ce que le musée a à m’offrir, avant de sortir sous une pluie encore bien battante.
Retour à la réalité, pour la deuxième fois de la journée.
Il me reste encore quelques heures à passer à Rennes, avant le départ de mon train et, de fait, de ma place attribuée (carré famille/couloir, pourquoi je réserve TOUJOURS au dernier moment). Mon cœur s’apeure et mes tempes s’affolent à l’idée d’une gare bondée, des gens stressés, de la pesanteur des dimanches soirs, déjà si éloignés du week-end en soi et mentalement trop proches du lundi, de la vie la semaine.
Je me dirige donc (après un petit détour à la boulangerie Vannier, qui n’a rien perdu de son prestige pâtissier d’antan) à La Criée, centre d’art contemporain. Car oui, sans maison, mes points de repères sont les institutions. C’est, encore une fois, trempée, que je franchis la porte, me dirigeant vers les médiatrices, qui prennent mon sac en échange d’une feuille de salle. Habituée des lieux mais pourtant rarement (pour ne pas dire jamais) à l’aise dans ces espaces ouverts et blancs, je me dirige tout de suite vers la salle noire, généralement réservée aux vidéos. C’est le cas ici : l’artiste Félicia Atkinson y propose deux œuvres qui, présentées ensemble, n’en font qu’une, mais qui ne sont justement pas toujours destinées à être présentées ensemble (d’où leur potentielle indépendance, si vous suivez). Coussins et tapis au sol apparaissent comme une invitation extrêmement appréciée en ces temps humides d’un dimanche qui fait lui-même suite à une bien éreintante semaine (de sueur et de labeur, ouais). Félicia Atkinson met en place, et ça tombe particulièrement bien, un espace de relaxation qu’elle construit par l’assemblage de sons, de vidéos en plan fixe (ou presque) et de mots, ayant pris forme suite à une résidence en Californie et un déménagement en Bretagne. Des sons doux, des bruits blancs, des ruissèlements d’eaux et des voix d’enfants, sans lien ni véritable sens se confondent à des images de désert, de cactus et de Grands Canyons, des mots et des poèmes, des mots écrits et décrits. Je reste longtemps dans ce cocon chaleureux, allongée, les yeux clos, mes muscles se détendant pendant que mes vêtements sèchent tranquillement. Suite à cette séance de médiation, je profite de mon état d’apaisement qu’a construit cette faille spatio-temporelle pour lire en silence la feuille de salle, où l’artiste raconte elle-même ses œuvres, ce qu’elles sont, ce qu’elles font, leurs liens, et nos liens à nous, ici au centre d’art. En sortant de la pièce noire, mes yeux peinent à s’ouvrir dans l’éclatant white cube, adoucit cependant par les installations de Félicia Atkinson, aux couleurs pastelles, aux formes arrondies, à l’esthétique délicate et chaleureuse, dans l’air du temps. Les objets, les tableaux, les matières, s’enchevêtrent les uns aux autres, au sein d’un puzzle géant que les récits de l’artiste assemblent.
Poussée par les étapes de l’exposition elle-même fixée par les lois de l’institution comme espace de monstration de l’art, je prends ensuite le temps de feuilleter les livres d’une pièce dédiée, prenant note de certaines références, comme ce bouquin de Balard qui m’était inconnu, une édition récente. Je chope au passage quelques flyers que je trouve jolis, qui feront leur temps dans mon sac ou comme marque-page, avant de finir au mieux dans une boîte d’inspirations, au pire dans la poubelle aux cartons (triste sort de ces milliers de flyers que je prends partout, tout le temps.)
Quand je sors, il est finalement temps de prendre mon train. Train duquel je vous écris, toute ambiancée par le siège « bureau » de mon wagon, qui me donne une bonne alternative à l’espace famille auquel j’étais pourtant presque condamnée, et par cet après-midi littéralement passé entre des murs dédiés à l’art, me poussant à lui déclarer ma flamme, à cet art.
C’est que cette journée passée à Rennes, au cinéma, au musée, puis à La Criée, ressemble finalement à la plupart de mes dimanches, dans une ville ou dans une autre : je visite très régulièrement des lieux d’art et de culture. L’art est pour moi, public/spectatrice, une délivrance, un espace d’ouverture, une brèche dans le monde, une introspection sur la société et sur-moi-même. L’art me procure de précieux moments de rêverie, de réflexion. C’est une mise à distance sur le présent, un écart plus que nécessaire avec le quotidien… D’autant plus dans les moments les plus sombres. Manifestation, acte de liberté, je conçois l’art comme un face à face avec moi-même, avec aussi avec l’altérité, l’humanité. J’aime surtout l’art dans ses moments intimes, quand il est dans sa parure idéale, en deçà du capitalisme (le grand méchant) et tout ce qui va avec. C’est une intemporalité flottante, des moments, des espaces, des sensations et des pensées qui s’imbriquent. Des gens, aussi.
Je vous écris de ce wagon de train, cette lettre qu’il faut prendre comme une parole de cœur. Une déclaration qui surgit dans un contexte politique, qui m’inquiète, et rend l’art plus que jamais nécessaire.
Le journal Libération, numéro d’un entre-deux tours d’élection présidentielle est bien pliée dans mon sac, tandis que j’écris ces lignes.
Je ferme encore un peu les yeux.