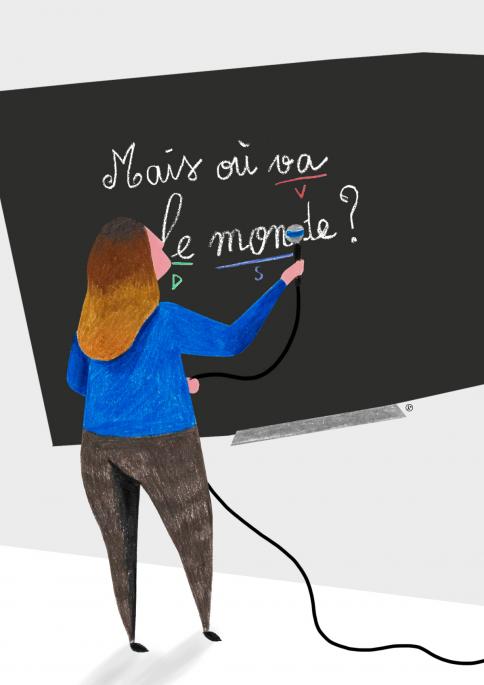J’ai décidé de te parler un peu de chanson française – une fois n’est pas coutume. Mais, quitte à faire la prof de la bande, et la prof de français qui plus est, je vais te parler un peu des textes. Je suis un peu un cliché, trentenaire-france-inter-télérama, tu vois le genre. Et je suis sûre que derrière ton écran, t’es peut-être un peu comme moi.
Je me souviens, gamine, j’écoutais beaucoup de chanson française, enfin, on en écoutait beaucoup à la maison. Ça allait de Brel à Brassens, en passant par Ferrat ou Ferré. J’ai appris mes mots préférés – stupre et fornication – chez Brassens et j’ai kiffé la métaphore pas très fine grâce à C’est Extra de Ferré. En somme, mes premières émotions de prof de lettres, je les ai un peu trouvées dans les textes de ces gens-là. D’ailleurs, niveau textes, ils envoyaient la poudre. C’était l’époque où les chanteurs mettaient les textes patrimoniaux en musique, Aragon, Rimbaud, Baudelaire. J’ai découvert Spleen et idéal en écoutant des chansons. Pas en lisant Les Fleurs du Mal.
Je te parle d’un temps… lointain. (Avoue, tu l’attendais, ma référence chanson française, là.) Aujourd’hui, il m’arrive encore parfois d’écouter de la chanson bobo-compatible. Oui, il faut que je te dise, c’est pas parce que je me trémousse sur un gros beat techno quand on se croise le samedi que ma culture musicale s’arrête là, et je suis sûre que pour toi, derrière ton écran, c’est pareil. Et là, tout récemment, mon oreille de prof de français a tiqué. « Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels » Tu vois pas le problème ? Dans cette phrase (extraite de Où va le monde de La Femme) par exemple, le si introduit une subordonnée… qui n’existe pas. Bon, ce n’est pas bien grave, mais ç’en est assez pour que je me pose une question : on en est où, niveau écriture des textes, dans la chanson en français en 2017 ? J’ai demandé à quelques ami.e.s ce qu’ils et elles écoutaient, et j’ai essayé de me demander quels étaient les faits saillants, linguistiquement. (Ça fait savant, tu trouves pas?)
La première chose que j’ai remarquée, c’est qu’on n’aimait plus trop les subordonnées. Par exemple, là, tu vois, il manque un « que » : « Et ça fait deux-trois jours /Que tu n’es pas bien /Tu ressasses le même discours/ Que t’es flippé parce qu’on est rien » (ça, c’est L’escalier de The Pirouettes). Ok, c’est pour que ça sonne mieux, et la subordonnée est bien là. Concernant les mots subordonnants, je ne résiste pas trop au plaisir de citer un autre exemple : « Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse » (toujours chez La Femme…), clairement, le relatif qu’on attend là, c’est un « auxquelles ». Donc on tord un peu le cou aux subordonnants, et après tout, ils l’ont bien mérité.
Mais plus globalement, j’ai un peu l’impression que personne n’aime les subordonnées. On leur préfère des structures en parataxe (ouais, encore un gros mot), on met les choses côte à côte au lieu d’expliciter les liens entre les propositions grâce aux subordonnants. Là, par exemple, c’est ce qu’il se passe : « Toi et moi sous les feux, /quand tes yeux ont brillé/Quand nos cœurs ont vibré » (dans Hieroglyphes, de Pépite). Si on était un peu strict niveau syntaxe, ce serait pas mal que « toi et moi sous les feux » soit le sujet de quelque chose… Mais quoi ? On ne sait pas. Les groupes syntaxiques sont posés, comme ça, les uns à côté des autres. Même chose chez Bagarre : « Le gouffre qui t’appelle, tu descends en rappel ». Là, du point de vue de la grammaire toujours, il manque un truc. « Le gouffre » (c’est le titre d’ailleurs) devrait être sujet et BIM, un pronom personnel sujet « tu » qui débarques. Et re-BIM, ta grammaire, elle boîte un peu.
Les constructions verbales sont parfois un peu hasardeuses, chez La Femme (oui, encore, désolée !), dans la chanson Septembre, on entend : « Celle qui me fera échapper /Du travail qui m’attend cette année ». Deux constructions existent : s’échapper de et échapper à. En l’occurrence, on devrait trouver « celle qui me fera m’échapper du travail… », et ce serait étrange ou bien « celle qui me fera échapper au travail… ». Et on a un mix entre les deux… Ça n’a l’air de rien, et ça sonne sans doute mieux, il n’empêche, c’est encore une petite liberté prise avec la syntaxe – en tout cas avec celle que je suis supposée enseigner à mes élèves.
Mais tu vois, ces morceaux, je les écoute, moi, et tu les écoutes sans doute. Et je suis pas là juste pour te dire que les morceaux que tu kiffes (et des groupes nommés aux Victoires de la Musique…) sont entièrement fautifs. Il en existe d’ailleurs d’autres avec de jolies subtilités. Par exemple, dans Grand Huit, de Maissiat, on entend un joli : « Tout est fini j’ai fait les ombres s’écarter » où le complément d’objet « les ombres » remonte avant le verbe à l’infinitif, un peu comme chez Racine. Et moi, je trouve ça beau.
Mais pourtant, dans tout ce qu’on écoute en français, il n’est pas rare d’entendre des choses un peu border niveau syntaxe. Et là, tu m’attends au tournant : discours de vieille meuf aigrie. Détrompe-toi. Mais, déformation professionnelle quand même, ça soulève quelques questions, que l’on pourrait d’ailleurs éliminer rapidement en sortant la carte licence poétique : tout ça est assumé, réfléchi et voulu. Merci. Bonsoir.
Pourtant, j’ai un doute. Et quand bien même ce serait le cas, il y a de telles régularités, sur la question des propositions subordonnées déjà, mais aussi sur les emplois de certains modes et temps (coucou le subjonctif et le conditionnel), que je me dis qu’il doit y avoir autre chose derrière. En effet, les textes de 2017 semblent plus proches d’une langue orale que ceux de 1960, ceux dont je te parlais au début, si t’as bien tout suivi. Et qui, en 2017, maîtrise parfaitement le subjonctif, les relatives, les constructions de chaque verbe, les accords de chaque participe quand il ou elle parle ? Personne.
Ce qui est donc assez chouette quand on écoute ces chansons, et quand on pense qu’elles plaisent aussi à un public plutôt cultivé, plutôt bobo et par conséquent plutôt attaché à la langue, c’est qu’on se rend vite compte qu’elles enregistrent un état de la langue. Comme lorsque l’on tombe sur un texte en ancien français, en somme, ou sur l’argot de Brassens. Et j’aime beaucoup me dire que dans cinquante ou cent ans, on pourra jauger l’évolution de la langue française à l’aune de ces textes qui resteront peut-être un peu plus que ceux des poètes d’aujourd’hui qu’on ne lit déjà plus beaucoup. Quand la liste des mots subordonnants se sera réduite à deux ou trois formes, on écoutera peut-être ces textes-là en pensant qu’ils disent quelque chose de l’état pas très stable du français en 2017. Presque comme les textes du XVème siècle quand on les lit aujourd’hui. Et finalement, c’est plutôt marrant.
PS : J’t’ai fait une playlist, si tu veux vérifier.
PPS : La prochaine fois, je te parle de rap français. PROMIS.