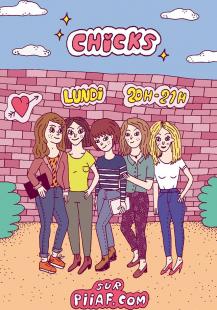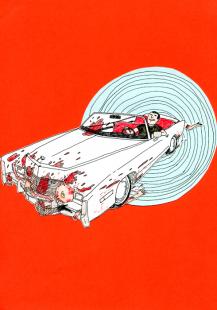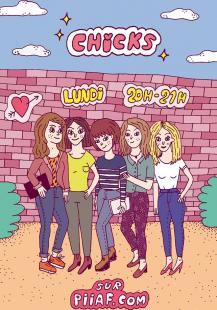« Vous envierez un peu l’éternel estivant,
Qui fait du pédalo sur la vague en rêvant,
Qui passe sa (vie) en vacances. » (1)
Début septembre à Paris, les feuilles mortes se ramassent déjà à la pelle, les magazines titrent « comment survivre à la rentrée ? ». Les mêmes magazines vous avaient précédemment enjoint d’un tout autre rituel : « se retrouver », « se reconnecter à soi-même et aux autres », « retrouver son partenaire », « raviver votre moi », tout en cultivant votre « bikini body », bien sûr.
« Cette année, j’ai fait une vraie coupure »
« Cet été, je me déconnecte, je me re centre, je prends du temps pour moi, pour mes proches, je me rapproche de la nature… ». Ces phrases, je les ai dites, entendues, vous les avez pensées, appelées de vos vœux, par anticipation de vos congés.
Pourquoi cet arrachement au travail, puis aux vacances, puis au travail, en un incessant recommencement temporel ? Je veux vous parler de la fable de la coupure. Les vacances sont considérées comme ce temps absolument libre, vacant, disponible à toutes les possibilités. En cela, elles seraient l’exact revers du temps « actif », qui est souvent temps du travail, occupé, surmené, plein, trop plein. Cette grande coupure temporelle, mentale, marque la distinction entre le rythme « habituel » et la trêve estivale. La pagination des journaux et magazines s’allège, « les vêtements raccourcissent » ainsi que les horaires.
La « rupture » est également géographique : lorsqu’on en a la capacité (financière), on visera des contrées pittoresques, ensoleillées,plus ou moins lointaines, pour « s’échapper » du quotidien.
Mais s’échappe-t-on vraiment, et prend-on vraiment le temps ?
Baudrillard (2) nous parle d’un « apparent dédoublement en temps de travail et en temps de loisir » (p. 243), nous susurre que « les vacances sont cette quête d’un temps qu’on puisse perdre au sens plein du terme, sans que cette perte n’entre à son tour dans un processus de calcul, sans que ce temps ne soit (en même temps) de quelque façon « gagné » » (p. 244)… mais que ce processus est, par nature, vain : ce temps « libre », nous l’avons acheté à force de travail, « à la sueur de l’année », c’est un objet en soi. Dans notre société de consommation, le « drame des loisirs », ce serait bel et bien « l’impossibilité de perdre son temps » (p. 238). La vacance, le vide qui serait inhérent aux bien nommées vacances, est tout bonnement inatteignable, car c’est du temps acheté, compris dans le temps consommé, dans le temps « comme valeur d’échange et comme force productive. » (p. 243), sans même évoquer ici l’évident coût financier intrinsèque des vacances. Bref, « les lois du système (de production) ne prennent pas de vacances ! » (p. 243) (3). Les vacances, c’est du boulot…
« Tu as passé de bonnes vacances ? »
Vous a-t-on déjà répondu par la négative ? Tentez l’aventure : dites que non, vraiment, les vacances furent mauvaises, tout au plus moyennes, rien n’y fit, ce fut raté. Votre interlocuteur esquissera sans doute une moue mi-incrédule, mi-angoissée, face à ce peine-à-jouir se tenant là. Comment cela est-il possible ? Les vacances, c’est le moment ou jamais où prendre son pied, s’amuser, sourire, bronzer, aimer ! Rater ses vacances, c’est une défaite au carré, toucher le fond, n’être plus homme…
Pourquoi devrions-nous à tout crin a-do-rer – et démultiplier notre « joie » par réseaux interposés ? Baudrillard nous souffle une réponse :
« L’homme-consommateur se considère comme devant-jouir, comme une entreprise de jouissance et de satisfaction. Comme devant-être-heureux, amoureux, adulant/adulé, séduisant/séduit, participant, euphorique et dynamique. C’est le principe de maximisation de l’existence par multiplication des contacts, des relations, par usage intensif de signes, d’objets, par l’exploitation systématique de toutes les virtualités de jouissance.
Il faut tout essayer : car l’homme de la consommation est hanté par la peur de « rater » quelque chose, une jouissance quelle qu’elle soit. On ne sait jamais si tel ou tel contact, telle ou telle expérience (Noël aux Canaries, l’anguille au whisky, le Prado, le L.S.D., l’amour à la japonaise) ne tirera pas de vous une « sensation ». Ce n’est plus le désir, ni même le « goût » ou l’inclination spécifique qui sont en jeu, c’est une curiosité généralisée mue par une hantise diffuse – c’est la« fun-morality », ou l’impératif de s’amuser, d’exploiter à fond toutes les possibilités de se faire vibrer, jouir, ou gratifier. » (p. 112)
Et encore :
« En fait, l’obsession du bronzage, cette mobilité effarée au fil de laquelle les touristes « font » l’Italie, l’Espagne et les musées, cette gymnastique et cette nudité de rigueur sous un soleil obligatoire, et surtout ce sourire et cette joie de vivre sans défaillance, tout témoigne d’une assignation totale au principe de devoir, de sacrifice et d’ascèse. C’est la « fun-morality » dont parle Riesman, cette dimension proprement éthique de salut dans le loisir et le plaisir, dont nul désormais ne peut se dispenser – sauf à trouver son salut dans d’autres critères d’accomplissement. » (p. 245).
Quelque 45 ans après l’ouvrage de Baudrillard, ce processus semble porté à incandescence par les réseaux sociaux. C’est le concours permanent de la plus belle carte postale en temps réel. Pour réussir la photo parfaite, celle qui s’attirera le plus de commentaires élogieux, on s’y prend à plusieurs et à plusieurs reprises, trouvant l’angle, la lumière, le filtre, la moue et le sujet idéaux. C’est un narcissisme d’un genre nouveau, qui passe par la production-consommation de soi-même. On s’y aventure comme auto-entrepreneur de soi (et de certains autres dûment choisis), pas mécontent que quelques vendeurs franchisés (les « amis » du réseau) fassent la promotion de sa petite entreprise par commentaires et partages interposés. Si par malheur, cette entreprise ne trouve pas preneur (ni « like », ni commentaire) : « F5, F5, fuck ! Me serais-je mal marketé ?», te demandes-tu avec angoisse, toi qui ne cherchais qu’admiration et concupiscence.
« Cet été, je prends le temps »
Cependant, d’aucuns (sur)jouent la fable de la coupure. Plus le contraste entre les deux apparentes temporalités est grand, plus grand semble le « prestige » qu’il confère aux existences : d’une part, la« « servitude » affectée des hauts cadres et des PDG, qui se doivent de travailler 15 heures par jour » ; d’autre part, ces mêmes cadres choisiront, peut être, des vacances « déconnectées », « loin de tout », presque ascétiques, « loin de la foule », « sans apprêt ». Sur un registre apparemment à l’exact opposé, ce faisant, se joue un air connu : « TTU (4), il ne faut rien faire ! »
C’est alors le mythe de l’oubli qui intervient, mythe auquel on tente de croire et qu’on tente de faire croire autour de soi : « j’ai vraiment coupé, cet été ». Pour Baudrillard, « la détermination fondamentale (du loisir) est la contrainte de différence vis-à-vis du temps de travail. » (p. 251). Cette valorisation de l’anti-consommation est, pour Baudrillard, « méta-consommation » et « joue comme exposant culturel de masse » (p. 130) : « c’est sur la base du luxe que se consomme la simplicité perdue » (p. 131).
A cet égard, j’ai toujours été frappée de l’existence et de la réussite des centres de « détox », qu’elle soit alimentaire ou numérique, qui fait payer à prix d’or à ses clients le non-accès à internet, ou l’assiette de carottes râpées.
Ou bien, à la manière de ces éditorialistes qui prennent congé de leurs lecteurs quand vient l’été, en écrivant ostensiblement qu’il ne faut pas les chercher, les guetter sur les réseaux sociaux, qu’elles seront indéchiffrables cet été ! Un surcroît de mystère et d’humilité qui est surcroît de présence et orchestration de la pénurie de soi… jusqu’à l’édito de rentrée.
Dans une moindre mesure,je caresse aussi ce rêve de dénuement l’été venu : petite fille aux pieds-nus, revenue à un monde d’avant-la-chute,retrouvant les « vraies joies simples » : dormir, marcher, manger, rire, échanger, aimer.
Baudrillard me recadre : cette « dépense » du temps dit libre, c’est le moment d’une « production statutaire », qui permet non plus de jouer la « survie économique », comme durant le reste de l’année, mais bien le « salut social » (p.245). Voici venue la morale de la fable : « Le loisir n’est pas la disponibilité du temps, il en est l’AFFICHE. »(p. 251).
Il y aurait alors tant à dire sur les liens entre cette « fun-morality », la société de consommation et de loisir et les réseaux sociaux. Quand on produit un statut, une photo sur un réseau social, ramassé en une phrase, slogan ou devise, on peut se croire débarrassé du fardeau de sa complexité, libre enfin de n’être plus que la face émergée de soi-même (5).
On affiche divers signes, qui un parasol, qui un sac de marque, qui une bande d’amis hilares. Tout est mis en oeuvre pour bien montrer que « ça y est, on ne fout plus rien / on s’amuse beaucoup, on l’a bien mérité, après avoir pris le métro et bossé toute l’année !»
La fable de la coupure a des fonctions bien utiles à notre société de consommation, mais elle m’épuise, je me prends à rêver à l’absence de temps de certaines sociétés anciennes, où le temps n’est que le « rythme même de l’échange » (p. 241), le pur flux de la vie. A propos du salariat, Mona Chollet livre que « ce découpage du temps (…), je le vis comme un carcan. Je n’aime pas la séparation sournoise d’avec moi-même qu’il induit, l’exil dans lequel il me maintient. » (p. 118) (6). A rebours, elle prône les vertus sous-estimées de la sédentarité et du temps pour soi « volé » au rythme en vigueur.
Pour une joie sans fin !
Métro, début septembre, le regard mort a fait son grand retour dans le métro. La fatigue semble, de nouveau, pouvoir avoir cours.
En moi, une sourde envie de ne pas « rentrer », de voguer à la frontière des temps, entre présence, congés, école buissonnière, dans des inter-mondes irréels où l’on rêve, on créé, on erre. Je ne veux pas m’évader du quotidien, car je veux l’habiter. Blackberry éteint, le cyclope à l’œil rouge est, momentanément, mort.
Antonio Gramsci écrivait le 1er janvier 1916, à propos du nouvel an (7) :
« Chaque matin, à me réveiller encore sous la voûte céleste, je sens que c’est pour moi la nouvelle année. (…) Je veux que chaque matin soit pour moi une année nouvelle. Chaque jour je veux faire les comptes avec moi-même, et me renouveler chaque jour. »
Pensez à manger, dormir, respirer, marcher, rêver, traîner, vous ennuyer, aimer, échanger chaque jour. Refusez les solutions de continuité. Infusez votre travail de rêverie. Infusez vos loisirs de créativité, mettez-y du vôtre, n’immortalisez pas ce mouvement de l’âme. Hackez vos jours de bureau. Suicidez votre selfie-stick. Travaillez après le travail. Professez une joie sans fin.
(1) G. Brassens, Supplique pour être enterré à la plage de Sète.
(2) J. Baudrillard J., 1970, La Société de consommation, Paris, Denoël, 317 p.
(3) Bon, il y a ce triste et beau passage où Baudrillard nous rappelle que nous sommes l’excrément du temps et l’excrément de l’argent, mais je vous l’épargne à de pures fins de santé mentale en cette « rentrée ».
(4) « très très urgent », en novlangue de bureau.
(5) Cette notion d’affiche n’est pas sans rappeler l’expression même de « facebook ».
(6) M. Chollet, 2015, Chez soi : une odyssée de l’espace domestique, éditions Zones, 250 p.
(7) Avanti!, édition de Turin, rubrique « Sotto la Mole », traduit par Olivier Favier.