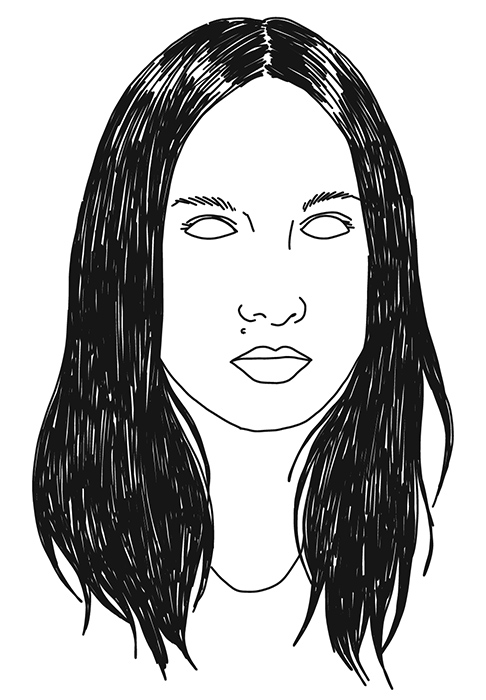Je vivais là, dans une lumière qui est plus forte que la vraie, plus pénétrante. Une lumière qui ne laisse pas d’angles morts. Partout l’on me voyait, et je ne pouvais me curer le nez sans que toutes les personnes présentes ne s’en aperçoivent. Ce qui sortait de ma bouche était important, et souvent décidé à l’avance. Pas toujours, bien que souvent. J’avais parfois le droit de dire « ce qui vient ». Cela est risqué car cela peut ne pas convenir, être dénué de talent ou d’à-propos.
C’est en cet endroit étrange qui cumule tous les artifices avec l’acceptation tacite de chacun des participants (ceux-qui-font, et ceux-qui-sont-tout-simplement), que se déploie une vie parfois plus réelle que la réalité, plus essentielle que le quotidien.
Le temps n’y est pas celui qui file dans la rue, les magasins ou les trains ; tout ce qui ne saurait se passer en une journée de votre vie peut ici s’y dérouler en une heure. Les échanges prononcés résultent d’une mûre réflexion ; ils singent ceux que vous entretenez avec votre amant, votre professeur ou votre grand-mère. Le jour et la nuit y sont factices, orchestrés par des gens dans l’ombre, pourvus de capacités spéciales. Le jour et la nuit existaient parce que nous, mes complices et moi, le décrétions. Et s’il nous prenait l’envie de faire tomber la pluie, qui nous empêchait ?
Mais le théâtre se répand aujourd’hui aussi sur certains bouts de trottoirs, dans le champ voisin ou cette usine qui autrefois produisait des yaourts. Parfois il vous laisse indifférent. Ou bien il vous prend aux tripes et par surprise. Pas toujours, bien que souvent. Du moins je l’espère.
Il m’est arrivé d’y rencontrer des êtres dont je ne soupçonnais pas l’existence (et toujours il y avait, pour assister à la rencontre, d’anonymes témoins ou d’amicaux visages ). Ces êtres m’ont habité pour un temps et par leurs yeux j’ai perçu le monde : un chien qui passe, une bouteille qui tombe, un ami qui pleure… Je les ai accueilli et me suis faite Parole par ma bouche, Destin par mes jambes, Homme par mon cœur, Espoir par mes poumons. Je leur ai offert mon sang et mes pieds pour qu’ils vous parviennent, leur ai prêté ma respiration parfois trop courte, ma voix parfois trop peu convaincante.
Et ces âmes, petit à petit, à force de fréquentation, je les ai reconnus comme d’imperceptibles bouts de moi. Ils s’appelaient Pinocchio, Célimène ou Médée. Titania, Roxane ou Alidor. Parfois juste « La Mère » parce qu’elle était mère, ou « Elle » parce qu’elle était femme. Mais il y eut aussi des sans-noms, de ceux qui n’ont pas la parole pour raconter leur histoire : des poilus devenus sourds sous les obus, des malades de la peste, des « prévenus » broyés par l’administration pénitentiaire. En huit années de formation pour devenir comédienne, j’ai rencontré de truculents trublions, d’enragées magiciennes, de déchirants agonisants…
J’ai donné vie à un pantin de bois dont le cœur semblait de pierre ; celui-ci engueulait son cher papa pour n’avoir pas assez d’argent et ne pas lui acheter de beaux livres afin d’être à l’école comme tous les autres, se fondre dans la masse. En lui je me suis reconnue toute jeune fille qui se cherche, dans mon collège marseillais haut perché, avide de reconnaissance et de respect : je voulais une paire de Nike pour être celle-qui-est-semblable, un survêtement flambant neuf pour ne pas faire de vagues, être celle que jamais on ne malmène mais bien plutôt celle que l’on aime. A la fin de notre aventure à Pinocchio et moi, mon professeur d’art dramatique m’a dit :Je savais que vous deviez le jouer, vous avez tellement la pré-science de la belle femme que vous allez devenir que vous préférez rester une marionnette pour l’instant. J’attends toujours la belle femme ; il m’arrive de l’entrevoir au bout de la rue, sous le lampadaire. Nous faisons alors un bout de chemin ensemble et cela est bon.
J’ai fait couler sur mes joues les larmes de Célimène, précieuse qui ne peut se résoudre à être la simple figurante d’une histoire d’amour universelle : elle veut être dans la lumière de quelqu’un, et si possible de tous. Mon partenaire interprétait Alceste, l’intransigeant et absolu prétendant qui ne peut souffrir qu’un autre homme jouisse des faveurs de Célimène. Je me souviens de la fin de cette répétition, j’essuyai mes larmes, le jeu terminé, nos dernières répliques échangées, et mon complice me demanda, terriblement inquiet :
-Je t’ai fait mal pendant qu’on jouait ?!
-Tu veux dire physiquement ? Non, pourquoi ?
-Ben, tu pleures.
-Non c’est elle qui pleure, elle a mal d’être elle. Moi ça va formidablement bien !
Je me suis échappée d’un hôpital psychiatrique, avec l’aide improvisée des spectateurs, j’ai assisté à mon propre enterrement, moi si terrifiée par l’idée de la finitude, et me suis rendue en dansant sur un air d’accordéon à ma propre tombe, creusée amicalement par un complice.
J’ai connu des ouvrières wallonnes qui avait tenu une grève acharnée en 1966 pour obtenir de meilleures conditions de travail. Elles exigeaient un salaire égal aux hommes pour une tâche égale. J’ai gonflé d’air mes poumons pour chanter avec elles et avec hargne : Le travail c’est la santé, rien faire c’est la conserver/ Les prisonniers du boulot ne font pas d’vieux os !
Je n’ai (hélas?) pas connu la visite de jeunes amoureuses, de jeunes premières. Elles n’ont pas fait le chemin. Peut-être ne les a-t-on tout simplement pas guidées? Mes professeurs et metteurs en scène supposaient-ils que la rencontre se passerait mieux avec quelque marâtre, quelque homme courageux ou quelque soldat que la raison abandonne ? Supposaient-ils que je n’étais pas la meilleure interlocutrice pour ces jeunes fleurs fragiles ? Peut-être est-ce moi qui n’ai pas levé assez haut la lanterne de l’entrée afin qu’elles se repèrent dans la nuit ?
C’est une chose étrange d’avoir côtoyé profondément tant d’êtres et de se méconnaître soi-même. A force de respirer comme eux, on en oublie son propre souffle. Je suis aujourd’hui comme pleine d’eux et vide de moi. Le théâtre est en jachère tandis que mon potager grandit. J’ai fait l’acquisition d’une maison là où finit la terre et y travaille à redessiner mes contours, en commençant par les fondations.