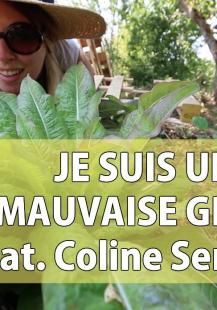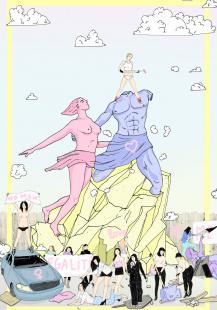« The world is changed, I feel it in the water, I feel it in the earth, I smell it in the air. »
On l’avait crue disparue. Pourtant elle est toujours là, à l’ouvrage, ou juste présente dans les inquiétudes de notre époque. Qu’est devenue cette mystique à l’ère 2.0? Quelles formes a-t-elle prises, et quelles œuvres a-t-elle accomplies depuis les figures de Circée, d’Iseult, de la fée Morgane, de la Banshee ou la fée Carabosse ? Figure d’indépendance et de puissance, la sorcière a longtemps incarné une place négative dans la culture populaire, avant d’être récemment réhabilitée – jusqu’à devenir une icône féministe aujourd’hui. Si on suit des poncifs narratifs, il faut savoir d’où elle vient pour savoir où elle va : de quelle noire forêt, quelle retraite, quel art secret elle est issue, pour être émulsionnée en blogs divers et variés ? On réalise assez vite qu’il n’y a pas une, mais des sorcières, bien différentes les unes des autres, hier et aujourd’hui. Elles ont quitté le roman gothique, pour être dans la vie quotidienne. Ici un état des lieux de cette figure à la croisée de domaines variés et antagoniste.
Le dictionnaire définit une sorcière comme une personne dotée de pouvoirs surnaturels, potentiellement de la faculté d’opérer des maléfices avec l’aide du diable ou de forces malfaisantes. Clairement dans son acception commune la sorcière n’est pas en odeur de sainteté ! Historiquement il s’agit de femmes vivant en dehors de la société. Même si les femmes ermites ont toujours existé, comme Marie-Madeleine dans l’Histoire sainte. Or, depuis les temps mythiques, du péché originel d’Eve, ou de la boîte de Pandore, existe l’idée de ces femmes qui ont entre leurs mains une puissance néfaste – comme celles qui conduisent soi-disant. On le voit chez la célèbre trinité de sorcières mises en scène par Shakespeare dans Macbeth : elles sont un parallèle malveillant des Parques antiques. Puisqu’elles ne prophétisent pas seulement, mais provoquent la tragédie. Elles sont aussi réunies dans Yama-Uba, sorcière de la montagne, tisseuse dans le Château de l’araignée : réactualisation en 1957 dans la culture féodale japonaise de Macbeth par Akira Kurosawa. Le réalisateur y incorpore les codes du théâtre Nô : une représentation ascétique des passions et de la folie du pouvoir, clinique de la barbarie, d’où naît une forme d’horreur tranquille, ourdie par cette sorcière toute en retenue. La sorcière est présente dans toutes les cultures, et sous toutes les formes, une figure universelle.
La sorcière est donc dans l’inconscient collectif une figure malfaisante, la femme en noir, souvent, vieille moche, aigrie et rieuse à la fois… Paradoxale dame, donc. Cette colère vengeresse à la fois jouasse, est parfois perçue comme de la démence : ce qu’incarne brillamment Helena Bonham Carter par le rire sardonique du personnage de Bellatrix Lestrange, méchante de la saga de sorcellerie Harry Potter. Le sombre uniforme est employé aussi bien par la reine de Blanche-neige, qui se retrouve under cover, pour l’entourlouper, à endosser l’apparence la plus suspecte qui soit, dans le film de Disney, qui défie les lois de la logique. C’est cette image que nous vend la bringue des supermarchés pour Halloween, nouveau sabbat consumériste. On représente la sorcière aujourd’hui volontiers hirsute, car ce qui choque chez certaines femmes – depuis le moyen-âge jusqu’à récemment dans l’histoire de l’habillement – c’est qu’elles ne portent pas de coiffe. Le poil est alors symboliquement associé à la bestialité, la Bête. Il est toujours domestiqué et contraint, par des coiffures souvent complexes. Il est maintenant traqué jusqu’au dernier dans une obsession hygiéniste sur le corps des femmes, par les esthéticiennes. Egalement, la sorcière des contes médiévaux, est avec l’ogresse, l’affreuse marâtre une figure « anti-maternelle », qui maltraite les enfants, les cannibalise : comme la sorcière d’Hansel et Gretel, qui les farcit de bonbons, pour mieux les caraméliser au four par après. La méchante parfaite, coupable idéale.
Genèse
L’événement historique qui cristallise cette image sont sans conteste les procès de Salem, riche port marchand de Nouvelle-Angleterre, en 1692-1693. Le Salem Witch Museum lui-même met en scène comme logo cette image cartoonesque de femme au nez crochu, chapeau pointu et balais. Alors que le chapeau pointu aurait été seulement l’habit des pionniers (hommes). Les modalités de cette fièvre dénonciatrice demeurent aujourd’hui mystérieuses, mais prennent clairement racine dans le mode de vie des puritains colonialistes. D’abord trois jeunes filles puis d’autres adoptant un comportement étrange se mettent à désigner comme responsables de leurs maux plusieurs personnes (qui elles-mêmes sous la torture en désigneront d’autres). L’Histoire et le cinéma ont cristallisé cette image d’une hystérie collective (qu’on retrouve dans certains teenage movies). Salem est devenu le trope d’un délire collectif de jeunes filles en fleur. L’événement lui-même se retrouve mis en scène dans pas mal de séries américaines sous forme d’épisode spécial avec déguisements (comme pourrait l’être Noël, Halloween, Thanksgiving, etc.). Dans la sitcom Sabrina the teenage witch, par exemple, cet épisode met évidemment en scène l’arch-enemy de l’héroïne – Libby aka la peste pom-pom girl surpopulaire du lycée – en menteuse affabulatrice. Entendre toujours le même récit d’un événement dont on sait si peu ne laisse pas d’interroger. On retrouve par ailleurs ici l’usage courant – mais peu recommandable – de blâmer la victime : comme l’historien Erik Midelfort, qui après s’être penché sur la chasse aux sorcières en Europe et avoir déduit une situation de misogynie, parvient à dire que ces femmes se mettent elles-mêmes dans une position de bouc-émissaire (champion).
Au sujet des heures sombres de la chasse aux sorcières, l’essayiste Mona Chollet, a jeté un pavé dans la mare, qui a été beaucoup repris par les journaux culturels, féministes et les réseaux sociaux. Elle explique que les sorcières représentent des femmes qui se définissent sans les hommes – de manière assumée ou fortuite – et en payent le prix : elles ont été il y 500 ans au bûcher, mais on les retrouve aujourd’hui mises au ban dans l’imaginaire collectif. En effet elle ramifie de la figure de sorcière trois archétypes féminins majeurs : la mégère, la femme sans enfant ou la célibataire endurcie. On semble découvrir ces 100 000 femmes accusées de sorcellerie, tuées entre le XVème et le XVIème siècle : un féminicide à grande ampleur, dont l’Histoire a été effacée. Chollet lutte ainsi contre la complaisance de toute une société envers ces crimes de femmes. Il est de fait souhaitable qu’avec l’arrivée de plus en plus de chercheuses femmes, que le paradigme change, et que l’on comprenne que si l’Histoire est toujours écrite par les vainqueurs, l’Histoire de la société est assurément celle des hommes. Cela permet de comprendre comment cette vision coercitive des comportements féminins agit toujours aujourd’hui. Mona Chollet tend par exemple un fil rouge entre la caricature de la « célibataire à chats » et la sorcière avec son familier, sujet démoniaque dans une forme animale (à ne pas confondre avec des types de sorcellerie où les sorcières ont un contrôle sur les animaux, comme élément de la nature).
C’est un des enjeux de cette réhabilitation par la recherche de la figure de la sorcière : admettre qu’il s’agit d’un véritable féminicide dès la Renaissance, négligé jusque là par les historiens. Et non au Moyen-âge comme on tend à le croire, ni par l’Inquisition, mais principalement par des cours civiles. La sociologue Silvia Federici ou l’historienne américaine Anne L. Barstow ont clairement affirmé que c’était un phénomène misogyne, dans une période de basculement de nos sociétés vers un système capitaliste. Une femme dotée de connaissances, le corps libre, fait figure dans leurs écrits de résistante anticapitaliste. Un élément retord que la société a cherché à éliminer. Avec comme manuel pratique Le Marteau des Sorcières (Malleus Maleficarum), œuvre de propagande, qui place les femmes comme cibles faciles du diable. Cela prouve que la sorcellerie est pensée d’abord comme un crime féminin, avec proportionnellement peu d’hommes jugés pour sorcellerie, et considérés comme dévoyés par une femme. L’essayiste Guy Bechtel – spécialiste des ombres de la charnière Moyen-âge/Renaissance – parle d’opération médiatique contre les sorcières : utilisant l’imprimerie naissante, les sermons, les images. De tout cela nous reste une liste de noms, de ces femmes ayant défrayé la chronique, sadiquement assassinées : Adèle à Toulouse en 1275, Marie Martin à Neufville-le-roi en 1585, Agnès Sampson à Edimbourg en 1591, Madeleine des Aymards en 1606, Anna Göldin à Glarus en 1782, etc, etc.
Toutes sorcières ?
Sans oublier celles qu’on n’envisage plus maintenant comme sorcières et qui ont pourtant été jugées comme telles. Par exemple Jeanne d’Arc. Puisque pour ses bourreaux et juges, les voix qu’elle entend ne sont pas celles de Dieu, mais celles du Démon. Luc Besson en a donné une vision alternative, dans son Jeanne d’Arc de 1999. De ce qu’on pourrait appeler très pudiquement la déconvenue de Jeanne : passant de sainte guerrière au bûcher quand-même… Il le donne à voir par une errance intérieure, illuminée de visions mystiques. Elle apparaît en femme énergique, agissante, sincère dans sa quête religieuse, mais aussi imparfaite, troublée par sa conscience, le Mal ou un Dieu cartésien (Dustin Hoffman). Avec une représentation originale d’une errance dans la foi, mais toujours dans ce stéréotype d’une femme instable psychiquement. On pense aussi à Erzsébet Báthory, comtesse sanglante de Csejte (pendant féminin de Vlad III, Dracula) : elle a été emmurée vive, pourtant sans preuve, hormis des aveux sous la torture. Sa condamnation très politique, a permis à la couronne Hongroise de spolier sa fortune et ses terres. Julie Delpy a redonné vie à la légende dans son film La Comtesse. Tout en dressant le portrait d’une femme torturée, mais aussi piquante, au sens propre comme au sens figuré. Les gens qui ont été traumatisés par le film savent…
La figure de la sorcière représente quelque part des forces vitales, volontés déchaînées. Puisqu’elle est parfois une sorcière vengeresse, comme la Alessa Gillespie (du film d’horreur Silent Hill, 2006), Helena Markos (du gialo Suspiria), la fantomatique présence du found-footage Blair-Witch (1994), ou bien l’ingénue Belladonna of Sadness (film d’animation fantasmagorique de 1973). Ou encore si on essentialise les ressorts psychologiques pour les enfants, Kahaba dans le film Kirikou, blesse car elle a été blessée. Elles ont ce schéma vindicatif pour mobile. Essentiellement une impulsion, qui prend le pas sur le reste : femme de pouvoir, femme hors de contrôle, femme qui ne se contrôle pas. On voit poindre cette idée d’une femme bestiale qui est l’objet d’une force supérieure. Carrément malveillante chez l’Isabelle Adjani du film Possession (Andrzej Żuławski, 1981). C’est d’ailleurs ce film auquel rend hommage plus récemment le clip du single « Voodoo In the Blood de Massive Attack’s : seule à l’écran, Rosamund Pike – actrice principale du thriller Gone Girl – est le jouet impuissant d’une présence inhumaine. Le clip est considéré en 2016 comme un morceau de bravoure d’acting, rappelant la danse de la sorcière de Mary Wigman, qui endossait par un masque les traits d’un démon sur son corps de femme. Or, ce sentiment d’altérité peut être expérimenté par chacune, comme le personnage de Gena Rowlands – A Woman Under The Influence (1974) – réalisé par John Cassavetes : tentant d’échapper désespérément à ses rôles d’épouse, de mère, de maîtresse maison, elle s’aliène au même moment le reste de la société.
Renaître des flammes
Avec ce passif qu’on ne saurait négliger, comment a pu s’opérer un tel retour en grâce, pour que le mot sorcière soit sur toutes les lèvres en 2018 ? Cheek Magazine dans un article sur les « nouvelles sorcières féministes » fait remonter le phénomène à 5 ans à peine, citant sur la scène artistique Princess Nokia (aka Destiny Nicole Frasqueri) et son titre Brujas (sorcière en espagnol), ou encore l’esthétique mystique de FKA Twigs. Un enjeu de cette nouvelle génération de sorcières, est de rappeler la diversité des sorcières, pas si éthérées, ou blanches que ça.
En effet à côté de la sorcière de noir vêtue, on trouve dans la culture occidentale la sorcière blanche, mystique ambivalente. Dans Narnia, elle est clairement maléfique, mais Galadriel a dans le Seigneur des Anneaux un rôle complexe, entre le bien et le mal. On en trouve une occurrence chez le personnage romanesque et pourtant bien réel, Hildegarde de Bingen. Une personnalité importante du haut moyen-âge nordique. Moniale iconoclaste, elle a créé son propre monastère, théorisé la thérapie par les plantes et écrit de la musique sacrée (trois fois rien en somme !). Aujourd’hui Sherin Khankan, imam au Danmark est ‘lune des seules musulmanes à diriger une mosquée, alliant féminité et mysticisme de blanc vêtu. Alors que pourtant rien n’interdit l’imamat aux femmes. Jamais non plus d’ailleurs une femme n’a été ordonnée prêtre catholique, alors que rien ne l’interdit non plus. Pourtant la possibilité est balayée dans les hautes instances du Vatican – des hommes – par l’argument que le Christ aurait appointé 12 hommes apôtres pour former son Eglise.
Croyances autochtones, paganisme et postcolonialisme
Revenant à la question de la sorcellerie : des formes indigènes de spiritualité, persécutées par l’église catholique lors de la colonisation selon l’anthropologue Ruth Behar, reprennent vie chez les jeunes générations de latinos. Une reconquête de leurs racines culturelles, dans une volonté postcoloniale. C’est entre autre de cela dont parle Princess Nokia, avec un clip cuté entre passé/présent, parcouru de references à Yemayá, esprit régent de l’eau, mère de toute chose vivante, dans la religion yoruba (issue d’Afrique de l’Ouest). Elle reprend aussi à son compte l’insulte « sorcière » dans une forme d’empowerment (comme elle l’avait fait pour Tomboy). D’aucun disent que le clip cite the Craft (film 1996 dont on a un peu surestimé la portée féministe, tant ses protagonistes sont représentées futiles et vaines). Mais on peut y voir plus largement le trope des collégiennes anglo-saxonnes pratiquant la magie – coucou le Winx club – mais cette fois-ci incarné par des femmes de couleur, avec moult références à cette culture magique caribéenne, la brujer‘ia.
FKA Twigs n’est pas en reste : dans le clip de Two Weeks, elle est à la fois déesse païenne et prêtresse, avec un chant qui la place tout à la fois comme filtre d’amour, potion, drogue, ou juste désir personnifié. Mais n’oublions pas qu’avant ça, Madonna, chanteuse pop, alliant sexy et mystique, cabaliste invétérée, chantait Frozen en 1998. Elle incarnait dans un clip très léché un sorcière métamorphe dans la vallée de la mort, sorte d’Hecate nighties, en prise avec le temps qui passe. En nous invectivant d’ouvrir notre cœur. Ce que chacun comprends comme il l’entend. Depuis Rihanna s’y est collé avec Where have you been. Ou Beyonce avec Ghost, ou dans un autre registre parce qu’elle a été accusée par une dame travaillant pour elle de sorcellerie malveillante. Les icônes de la pop versent de manière assumée dans un mysticisme étudié, esthétisé.
Sorcières militantes
Alors évidemment, avant d’être pop, la sorcière a parcouru un long chemin : des séances de spiritisme qui faisaient fureur de la fin du XIXème aux années 20, dans les écrits de Matilda Joslin Gage, première investigatrice connue sur le champ théorique du sujet de la sorcellerie, des mouvements contestataires des streghe dans l’Italie des 70’, avec leur « tremblez, tremblez, voilà les sorcières ! ». Egalement des lieux historiques de chasses aux sorcières qu’on a fait changer par la pugnacité de militants en mémoriaux (plus qu’en musées des horreurs, ou maisons hantées de bonnes femmes) : Gelnhausen en Allemagne, Glaris en Suisse, Fribourg, Cologne et Nieuport Belgique, Steilneset en Norvège (avec un monument créé en collaboration entre Peter Zumthor et Louise Bourgeois), etc.
Les sorcières 2.0 sont présentes aussi sur la scène médiatique et politique depuis un moment : le groupe WITCH, proposait sur les réseaux, on s’en souvient encore, de se rassembler à minuit, la nuit du 24 février, pour jeter un sort à l’ami Trump. Avec en cadeau bonus publié sur le net, un livre de sorts antifasciste. Le Witches International Troublemaker Conspiracy From Hell (acronyme du feu de Dieu) est un groupe de lutte intersectionnel qui existe en réalité depuis les années 60. Et son manifeste de 1968 est plutôt clair « Inutile d’adhérer à WITCH. Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l’intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière. » Le Yerbamala Collective, couvent digital de sorcières, œuvre dans la même optique sur les réseaux sociaux. C’est un groupe de théoriciens queer penchant vers l’occulte, des activistes, versant dans la création d’un art qui questionne et subvertit la logique écrasante du capitalisme, du colonialisme, du racisme et du patriarcat hétéro-centré. « Imaginant un future queer et utopique ». Un monde fabuleux en somme. C’est peut-être déjà à l’époque du WITCH que s’opère un tournant liant le queer et la sorcellerie (même s’il peut poser problème aujourd’hui, comme on le verra plus tard).
L’art mystique des sorcières a en effet certains attendus en commun avec la culture queer. On observe l’idée récurrente de repartir à la conquête de son corps avec, entre autres pistes, une corrélation entre les cycles menstruels et ceux de la nature, avec l’émergence des sorcières vertes. Il est clair que le sang menstruel avait besoin d’être réenchanté, tant il est tabou (il est toujours bleu à la télé…). Dans une optique éco-responsable, suivant le courant de pensée malthusianiste, revient dans le débat actuel le désir de ne pas enfanter, appelé Green Inclination, ce qui nous ramène à la typologie de sorcière énoncée par Mona Chollet, la femme mûre sans enfant.
Magical body
La corrélation entre sorcellerie et découverte de soi-même, de sa sexualité, de son corps, est éminemment présente chez la teenage witch. En forme de rite de passage, au sens propre. Celles-ci est à l’honneur dans les séries des 90’, mais aussi plus récemment ou dans leurs spin-off de cette année : depuis Willow dans Buffy, la saison Covent d’American Horror Story, les remakes de Sabrina, The Wizard of Oz ou Charmed (les drôles de dames de la sorcellerie). Ce qui lie ces séries : elle sont narrées d’un point de vue féminin ! Elles mettent en scène une image de la sororité : dans sorcière il y a sœur. Et pas seulement le cliché d’une sexualité débridée, s’accaparant le sexe masculin, dont le balai est le symbole (comme dans la série Salem). Le balai, qui est détourné par la sorcière de son rôle d’objet ménager, avec la maison depuis l’Antiquité comme sphère féminine. Rappelons que Charmed a longtemps été la série avec des personnages principaux féminins la plus longue de l’histoire du petit écran américain (jusqu’à ce que Desperate Housewives la détrône, en 2012). Les sœurs Halliwell sont ancrées dans le quotidien, mais n’en sont pas prisonnière comme Ma sorcière bien aimée, rendue inoffensive, domestiquée.
L’enchantement du corps est lié à une réflexion à l’opposée du courant de pensée rationaliste et du scientisme qui triomphent dans l’Occident moderne. Il offre une forme de résistance. On pense à la lutte contre les violences médicales et obstétricales dans les mouvements féministes par exemple. Dans l’espoir d’un ordre nouveau la sorcière verte a, pour certaines spécialistes, un rôle éminent à jouer, comme vecteur d’interconnexion avec le vivant, avec tous les autres êtres. La pratique de la sorcellerie de manière plus large appartient à un courant de mysticisme, en forme de lutte contre un monde cartésien et vide de sens : par exemple l’usage d’arts mystiques anciens comme le tai qi, le yoga. Ou une lecture du monde par le prisme des tarots ou des astres, etc. « Mais après tout, n’y a-t-il pas un peu de la sorcière cachée dans toute femme, quelque forme que cela puisse prendre ? » (Mary Wigman)
Vieille dame
Il n’y a d’ailleurs pas d’âge pour enchanter le monde, son enveloppe charnelle ou son esprit. La sorcière pose la question du rapport des femmes et l’âge. Elle donne des pistes pour ouvrir un nouvel imaginaire autour du célibat, de la vieillesse, du non-désir d’enfant. Cela affleure, même dans la mode, avec le menocore, tendance du ménopause chic (mélange du normcore et d’une aspiration à aller vers des formats plus amples, moins sensuels). Dans un autre registre Sophie Fontanel, à un moment de sa vie ne peut « plus se voir en teinture », et écrit sur le fait d’assumer sa chevelure blanche, de devenir « blande ». Elle réfléchit sur le double standard avec les hommes. Un sujet pas si trivial qu’il n’y paraît au premier abord : les femmes ont le droit – sans contraintes – à une autre beauté, au fur et à mesure que leur vie avance. Puisque l’apparence est aussi un gros investissement financier, qui creuse un peu plus les disparité économiques hommes/femmes. Avec protections menstruelles, non remboursées, la pilule, etc. Elle a l’impression paradoxale de rajeunir, de mieux se comprendre. A l’opposée de l’expérience contée par Anne Kreamer, dans Going Gray, sur le fait de disparaître derrière ses artifices vains, pour rester jeune (ses colorations sourdes et ses looks sombres). Et surtout elle développe un nouveau pouvoir d’attraction, y compris sur des hommes plus jeunes. Dans l’injonction faite aux femmes de paraître éternellement jeunes, elle voit une manière subtile de les neutraliser (Mona Chollet en parle très bien) : on les oblige à tricher, puis on prend prétexte de leurs tricheries pour dénoncer leur fausseté et mieux les disqualifier.
La sorcière est en définitive une figure très complexe à approcher, car elle s’est construite dans l’imaginaire de différentes époques et cultures, le tout mélangé dans le melting pot des mass medias. Construite avant tout par la perception négative d’une femme puissante qui agit trop sur le monde. Elle revêt aujourd’hui, outre l’existence réelle de certaines sorcières, des caractéristiques féminines diverses et contradictoires. Il faut en premier lieu se détacher de cette image de fille folle, pour comprendre la Wicca. Par ailleurs dans son blog, Céleste Chantelouve, parle de la concomitance des oppressions sur les personnes sorcières et les minorités de genre et d’orientation, déconstruit dans différents articles (Nos anciens alliés, Le stigmate du magicien, Nous existons encore) la tendance qui consiste à « se revendiquer de la sorcellerie du fait d’être féministe et/ou impliqué-e dans la défense des droits LGBTI+. Celle-ci consiste essentiellement à se réapproprier en les mêlant de façon douteuse les pratiques telles que le sabbat et les persécutions sous forme d’exécution par le feu. Il y a aussi une négation (méconnaissance (?)) des profils des victimes de cette persécution et des raisons invoquées pour les assassiner. » Il faut donc rester vigilants de ne pas spolier cette culture spécifique (alors qu’on l’évite pour d’autres minorités). Or, il n’y a sans doute pas de figure qui montre plus l’importance des role models que la sorcière. Après la douloureuse liste de celles qui ont péri par le passé, on pourrait commencer celle, joyeuse des nombreuses sorcières actives aujourd’hui, comme les célèbres Starhawk, Camille Ducellier, etc. Ou de celles qui ne le sont pas, mais militent, comme Carole Sandrel, Mona Chollet, Gloria Steinem et toutes ces femmes qu’on voit apparaître sur les étagères des bibliothèques, afin que la sorcière revive et demeure.
Bibliographie
Camille Ducellier, Guide pratique du féminisme divinatoire
A réalisé des films sur le genre, les sorcières
Jack Parker, blogueuse influente et auteure du livre Le Grand Mystère des Règles,
Starhawk, autrice néopaïenne américaine et figure incontournable de l’écoféminisme
Starhawk, Femme, Magie et Politique
Sophie Fontanel, Une Apparition
Gloria Steinem
http://www.topito.com/top-sorcieres-celebres-cramer-au-bucher
http://www.ztele.com/articles/top-10-des-sorcieres-les-plus-malefiques-au-cinema-1.1390057
http://www.dvdclassik.com/critique/le-chateau-de-l-araignee-kurosawa
https://www.highsnobiety.com/p/michele-lamy/